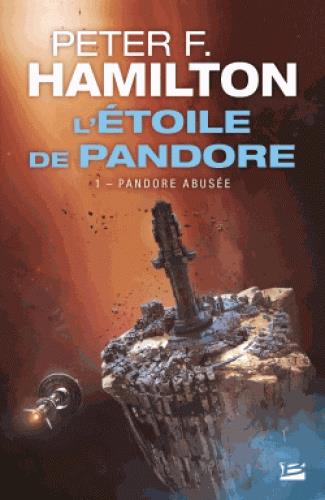Un veuf septuagénaire souffre d’une longue phase d’insomnie handicapante. Peu à peu, le manque de sommeil prolongé perturbe sa perception du monde. Mais souffre-t-il d’hallucinations ou voit-il la réalité telle qu’elle est pour la première fois ?
Titre : Insomnie
Auteur : Stephen King
Editeur : Albin Michel (ebook)
En y allant à gros coups de truelle, on peut séparer la très féconde carrière de Stephen King en trois grandes phases : la première, où il a signé une série de romans d’épouvante à succès, basés sur des idées simples et marquantes ; la deuxième, où il a enchevêtré la plupart de ses histoires autour d’une mythologie unique, celle du cycle de « La Tour sombre » ; enfin, une troisième période marquée par la rédaction d’un grand nombre de thrillers.
« Insomnie », publié en 1994, est l’illustration parfaite de la deuxième époque, puisqu’il est profondément enraciné dans deux autres œuvres marquantes de son auteur. Comme « Ça » (1986), son action se déroule dans la ville fictive de Derry, et on y retrouve des lieux et des personnages issus du roman en question. Quant à l’intrigue, elle est connectée très directement au cycle de « La Tour sombre ». Cela n’empêche pas le livre de pouvoir être lu pour lui-même, mais il gagne à être considéré dans ce contexte plus large.
D’une certaine manière, « Insomnie » fonctionne comme une relecture de « Ça », avec des personnages du troisième âge qui se substituent aux pré-adolescents de ce roman, et font face de leur côté à une incarnation du mal d’une nature différente. Le roman présente d’ailleurs quelques idées intéressantes autour de ce parallèle, notamment quand il présente la ville de Derry comme un empilement de réalités parallèles : la ville que voient les enfants n’est pas tout à fait celle dans laquelle évoluent les personnes âgées, les actifs, les criminels ou les policiers, etc…
Malgré tout, on a affaire à une histoire d’une nature différente. « Insomnie » est beaucoup moins ambitieux que « Ça », dont il n’a pas la dimension historique vertigineuse. Même s’il fait des centaines de pages, c’est finalement un roman assez simple, qui se concentre sur un petit nombre de personnage. Par ailleurs, c’est moins un récit d’épouvante qu’un roman qui verse régulièrement dans un surréalisme baroque souvent remarquable mais parfois un peu surfait. Il y a quelques frissons, mais pas beaucoup. Quant aux antagonistes, ils sont loin d’être aussi mémorables que le clown « Grippe-sou ».
Je me suis lancé dans la lecture de ce livre en y cherchant deux éléments destinés à nourrir mes propres projets d’écriture. Premièrement, je souhaitais comprendre comment Stephen King écrivait la transition entre les moments qui ne font pas peur et les moments qui font peur. J’y ai puisé quelques astuces, mais pas beaucoup. Chez King, la peur nait de l’attachement aux personnages, de la clarté des enjeux, et de la manière dont l’auteur se focalise sur certains détails marquants des personnages et de l’environnement, à l’exclusion de tout autres éléments de description. Dans ce domaine, il ne fait pas d’effets, il laisse parler l’intrigue pour elle-même.

Un autre aspect qui m’intéressait, c’était de comprendre pourquoi les romans de Stephen King sont aussi longs, à quoi ça sert, et comment il maintient l’intérêt du lecteur sur une telle longueur. Là, j’ai compris que sa manière d’écrire nécessite un grand nombre de pages, parce qu’il prend le temps de nous faire découvrir ses personnages principaux dans un grand nombre de situations avant d’introduire les éléments surnaturels de manière très progressive. D’une certaine manière, le premier tiers d’un de ses bouquins fonctionne comme un récit de littérature blanche, qu’on situerait quelque part entre Carson McCullers et Cormac McCarthy. Cela dit, il ne parvient pas toujours à maintenir la tension sur la distance : « Insomnie » comporte certaines longueurs, et l’auteur a lui-même concédé qu’il ne fonctionnait pas totalement en tant que roman.
Malgré tout, même dans une œuvre mineure, on reconnait l’expertise d’un vétéran de l’écriture. Si je vous résumais l’intrigue du roman, vous la trouveriez absolument ridicule. Mais en la découvrant au fil des pages, à travers des personnages auxquels on s’attache, King parvient à nous faire avaler les idées les plus grotesques. Tout ne fonctionne pas, cela dit. J’aurais aimé qu’il explore avec davantage de rigueur certains de ses thèmes, comme le troisième âge, la mort ou le féminisme. Ceux-ci sont utilisés au service de l’intrigue, mais à mon avis ils auraient pu apporter davantage et déployer des résultats plus poignants.
Et puis Stephen King est un camelot de l’écriture, et il sait prendre des raccourcis. Par exemple, à plusieurs occasions, il n’hésite pas à tordre les règles de la narration et à changer de point de vue au milieu d’une scène. Un auteur qui aurait davantage à prouver que lui aurait probablement cherché à trouver des solutions plus ingénieuses et plus élégantes, mais là, il a dû se dire que la plupart des lecteurs ne s’apercevraient même pas du tour de passe-passe. Il n’a sans doute pas tort, mais on aurait pu attendre davantage de rigueur de sa part.
En conclusion, « Insomnie » est un paradoxe. C’est un roman, pas raté, mais médiocre de son auteur, et en même temps, ses idiosyncrasies en font une œuvre singulière, qui n’aurait pas pu être signée par quelqu’un d’autre.