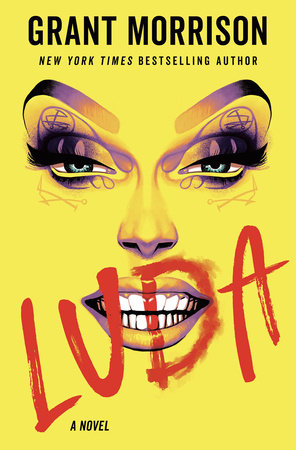De l’enfance à l’âge adulte, la trajectoire d’un apprenti magicien, surnommé Epervier, qui va, par arrogance, libérer dans le monde insulaire de Terremer une créature du néant qu’il va finir par poursuivre à travers le globe.
Titre : Le Sorcier de Terremer
Autrice : Ursula K. Le Guin (traduction Philippe Hupp)
Editeur : Le Livre de poche (ebook)
Depuis longtemps, je nourris le projet, sur ce site, d’évoquer les classiques de la fantasy. Bien souvent, lorsque j’évoque le genre avec des individus qui s’en disent amateurs, je constate qu’ils connaissent bien les oeuvres des trente dernières années, mais qu’ils n’ont jamais lu les classiques. C’est dommage, et c’est pourquoi je suis tenté d’écrire des billets sur les oeuvres de Lord Dunsany, Fritz Leiber, Robert Howard, Poul Anderson, Tanith Lee, Michael Moorcock, Jack Vance, Roger Zelazny, etc… Dans les faits, cependant, il faut bien que j’admette que mes critiques ne sont pratiquement lues par personne, et qu’un tel projet ne justifierait pas l’énergie que j’y mettrais.
Par ailleurs, j’ai moi aussi énormément de lacunes, et je ne suis pas une référence dans ce domaine. Dans le but de parfaire ma culture générale, j’ai donc décidé, sur un coup de tête, de me plonger dans un ouvrage qui est considéré comme un classique du genre, et que je n’avais jamais abordé : Le Sorcier de Terremer, d’Ursula K. Le Guin.
C’est un chef d’oeuvre. Je ne classe pas les livres, mais si je le faisais, ce roman serait allé se loger, avant même que j’en achève la lecture, dans les hauteurs de tous mes classements personnels. Il me paraît bien cruel que ce livre ait existé pendant toute ma longue vie sans que je m’y plonge. Enfin voilà, c’est fait.
Le récit nous présente une partie de la vie d’un personnage dont l’autrice nous raconte d’emblée qu’il va connaître une trajectoire illustre (dont l’essentiel n’est d’ailleurs pas inclu dans ce volume, et que Le Guin n’avait aucune intention d’explorer davantage à l’époque). On le découvre petit garçon, gardien de chèvre sur l’île de Gont, puis dans ses premiers tâtonnements de sorcier, lors de son apprentissage dans une école de magie, et enfin dans les années qui suivent son enseignement, où il va longuement payer une erreur commise en raison de son arrogance. C’est à la fois un bildungsroman, un récit initiatique et une fable sur l’hubris et la manière dont un individu peut parvenir à dompter ses démons intérieurs. Certains ont voulu y voir un précurseur des aventures de Harry Potter, sans doute parce qu’il y a une école de magie dans « Le Sorcier de Terremer », mais ni l’un, ni l’autre n’ont inventé ce concept et les deux oeuvres ont finalement très peu de choses en commun.

Parmi les tours de force du roman, son protagoniste, Epervier, ou Ged, un jeune homme difficile à aimer : arrogant et revanchard dès qu’il s’initie à la magie et dévoile tout son talent pour cette discipline, il devient progressivement amer et se referme sur lui-même, et ce n’est qu’à la fin du roman qu’il finit par découvrir qui il est et comment il fonctionne, et conquiert ses défauts les plus rédhibitoires. Entre les mains d’une autrice moins talentueuse, on aurait tôt fait de décrocher de ce roman au coeur duquel vient se loger un personnage si désagréable, mais elle parvient à nous attacher à sa destinée malgré tout, parce qu’on parvient toujours à comprendre ce qui l’anime, et qu’il finit par être la principale victime de sa prétention.
Le style du « Sorcier de Terremer » diffère des romans contemporains de fantasy (comme d’ailleurs de ceux publiés à l’époque). Le récit est écrit comme une fable, ou comme une chronique médiévale. L’autrice ne souligne aucun effet et s’interdit de s’apesantir sur les émotions ressenties par les personnages. Elle laisse parler les faits, souvent avec une certaine distance, et s’autorise des raccourcis où des événements qui auraient pu occuper des chapitres entiers sont résumés, voire expliqués par un narrateur omniscient qui peut paraître expéditif. Le résultat, c’est un récit très dense, où chaque chapitre nous plonge dans une situation nouvelle, et où le lecteur finit malgré tout par s’attacher aux personnages et aux lieux, une fois qu’il est parvenu à domestiquer les codes du roman.
Ce choix stylistique a un autre effet : il confère au livre un vernis de classicisme, qui dissimule avec effronterie son originalité et son caractère iconoclaste. Ici, rien n’est comme dans les classiques de la fantasy qui ont précédé Terremer, et à dire vrai, l’oeuvre est si singulière qu’elle détonnerait même si elle paraissait aujourd’hui. Ici, pas de grands continent semé de montagnes et de vastes prairies, mais un éparpillement d’îles ; pas de chevaux, mais des bateaux ; aucun des personnages principaux n’est un homme blanc ; on n’empoigne pas d’épée, d’ailleurs, on ne se sert pas de la violence pour régler les conflits. Quant à la magie, qui est par bien des aspects au centre de l’action, elle est à la fois traditionnelle et singulière, juste assez expliquée pour nous faire comprendre ses limites, juste assez mystérieuse pour qu’elle ne finisse pas par ressembler à de la mécanique.
Encore deux mots des derniers chapitres, où le récit prend quelques distances avec ce qui précède, du point de vue du style comme de celui du rythme. L’action se fait plus lente, les enjeux plus vifs, et les pages se peuplent d’une profonde mélancolie, alors que les personnages semblent disparaître au coeur d’un monde qui les dépasse, rappelant par moment la poésie d’un Robert Frost ou les romans de Charles Ferdinand Ramuz.