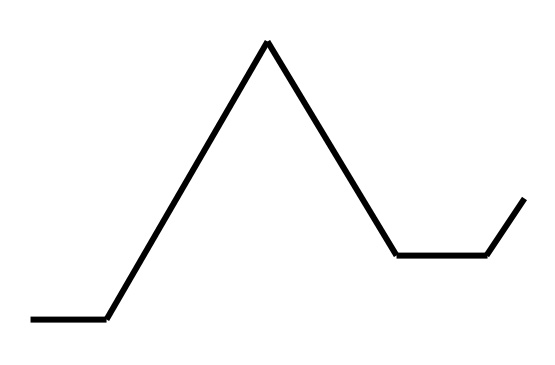Bien souvent, un antagoniste efficace est quelqu’un qui sait s’entourer. Après avoir examiné le rôle de l’antagoniste dans une œuvre de fiction, je vous propose ici de nous pencher sur un certain nombre de personnages annexes qui vivent dans son orbite et contribuent avec lui à rendre la vie dure aux protagonistes d’un roman.
Cela va de soi : aucun des rôles ci-dessous n’est indispensable, et chacun d’entre eux représente un stéréotype qu’il convient de développer, de subvertir et de traiter avec doigté et imagination afin de lui donner du relief et de l’intérêt. Je vous laisse un peu de boulot.
Le dragon
Bien souvent, c’est en tout cas l’option la plus classique, l’antagoniste d’une histoire n’est vaincu qu’à la fin. Lorsque ses plans sont déjoués, la tension narrative retombe et l’histoire se termine. Il est même très courant que protagoniste et antagoniste ne se confrontent que juste avant la conclusion du roman. Comment, dès lors, incarner la menace que représente l’antagoniste, comment compliquer la vie des personnages principaux en attendant ce fatidique face-à-face ?
Pour cela, il y a le dragon (un terme que j’emprunte à TVTropes). Il représente l’obstacle que doivent franchir les protagonistes avant de vaincre l’antagoniste. Alors que l’antagoniste est celui qui tire les ficelles, qui orchestre la série d’embûches qui se dressent sur le chemin des héros, le dragon est là, sur le terrain, pour se confronter à eux physiquement et leur rendre la vie dure. S’il est vaincu, cela représente une grande avancée, mais pas la victoire finale. Dans Star Wars, le rôle du dragon est tenu par Darth Vader.
Le dragon peut être le fidèle lieutenant de l’antagoniste, un mercenaire qu’il paye pour exécuter ses basses œuvres ou un allié qui accepte temporairement de jouer un rôle mineur. Il peut même s’agir d’un authentique dragon ou d’une autre créature fabuleuse. À noter que même en-dehors de la littérature d’aventure, le rôle du dragon peut très bien trouver sa place. Le tueur à la solde d’un baron de la drogue dans un thriller, le DRH sans scrupules qui exécute les basses œuvres d’un patron, la sœur acariâtre qui rapporte tout à un père manipulateur dans une saga familiale : ce sont tous des dragons.
Enfin, le dragon, comme l’antagoniste, peut avoir un arc narratif, il peut évoluer : il est même recommandé qu’il en soit ainsi. Un dragon peut nourrir ses propres ambitions, souhaiter prendre la place de l’antagoniste, ou, au contraire, trouver la rédemption et aider les personnages principaux à triompher de celui qui sera dès lors devenu leur ennemi commun. Comme l’antagoniste, plus vous consacrez de temps à comprendre ce qui le motive, meilleur sera votre dragon, et donc tout votre récit.
Les sbires
Si le dragon constitue l’obstacle qui semble infranchissable sur la route du héros, les sbires en sont les jalons, les accidents de parcours, qui viennent corser la vie des personnages principaux mais dont ils finissent par triompher tôt ou tard. Dans Le Seigneur des Anneaux, les sbires sont les Orcs, alors que dans Harry Potter, ce sont les Mangemorts.
Le rôle symbolique des sbires est de nous rappeler que l’antagoniste possède des alliés, des amis, une organisation qui le soutient, et que son pouvoir s’exprime à travers eux. Oui, il est possible de s’en défaire, mais pas de les éliminer tous : leur présence nous confirme que rien ne changera vraiment tant que les plans de l’antagoniste ne seront pas déjoués.
Même si les sbires constituent une menace diffuse et souvent désincarnée, sans nom et parfois sans visage, il est tout de même important de s’interroger sur ce qui les motive à épouser la cause de l’antagoniste. Qu’ont-ils à y gagner ? Agissent-ils par conviction, par intérêt, par peur ? Qu’est-ce qui serait susceptible de les faire abandonner le combat ou changer de camp ?
Attention cependant : plus vous humanisez les sbires, plus il va devenir inconfortable que votre héros les massacre par dizaines. La confrontation ne doit pas nécessairement prendre un tour violent. La simple présence des sbires peut obliger les protagonistes à ruser, à se montrer prudent ou à faire preuve de discrétion.

Le miroir
J’ai eu l’occasion de le dire : il est crucial que l’antagoniste ait de l’épaisseur, des objectifs identifiables et même une vie intérieure. Tout cela n’est pas facile à obtenir si on n’a aucun accès à ses pensées. Dans un roman où l’antagoniste est absent ou n’est révélé que dans les derniers chapitres, il risque de paraître creux et inintéressant. Une manière d’étoffer son rôle, c’est de lui donner un miroir, c’est-à-dire un autre personnage avec qui il peut dialoguer. Monsieur Mouche, dans Peter Pan, est le miroir du Capitaine Crochet.
Le miroir peut être un conseiller, un proche, un ami, un confident, un stratège. Quoi qu’il en soit, son rôle dans l’intrigue est de donner à l’antagoniste quelqu’un à qui parler, ce qui permet déjà de rendre certaines scènes d’exposition plus naturelles, mais aussi de mettre au jour les doutes et les contradictions psychologiques de l’antagoniste.
Par moments, le miroir peut faire office de conscience pour l’antagoniste, et tenter de le pousser en direction d’un comportement plus moral, ou au contraire, il peut l’inciter à commettre des actes de plus en plus répréhensibles. Il est même possible de mettre en scène deux miroirs différents, qui tiennent chacun un de ces rôles, comme les anges et les démons qui apparaissent sur les épaules des personnages de dessins animés.
Comme le dragon, le miroir peut lui aussi gagner à avoir un arc narratif, à avoir ses propres ambitions et sa propre ligne morale, distinctes de celles de son patron.
Le satellite
Le satellite est un personnage qui existe dans l’orbite de l’antagoniste mais qui ne participe pas à ses plans. Typiquement, il s’agit d’un membre de sa famille ou d’un être aimé : quelqu’un de proche, qui compte dans sa vie et qui, bien souvent, représente un aspect de son existence qui n’est pas directement lié à ses ambitions. Il peut s’agir d’un conjoint, d’un enfant ou d’un parent, mais aussi d’un ami, d’un mentor, de quelqu’un dont l’antagoniste aurait la charge. Il peut même s’agir d’une institution : une entreprise, une fondation, un orphelinat, un théâtre, allez savoir. Dans Le Parrain, l’épouse de Michael Corleone, Kay, est son satellite.
Il y a deux bonnes raisons d’adjoindre un ou plusieurs satellites à un antagoniste. La première, c’est que cela les humanise : si celui que l’on a jusque-là voulu voir comme un « méchant » se préoccupe sincèrement de personnes qu’il aime, est-il vraiment aussi mauvais que cela ? Cela peut même inviter le lecteur à reconsidérer sa position : et si c’était le protagoniste qui était dans l’erreur ?
Seconde raison de recourir à un satellite : cela donne un point faible à l’antagoniste. À partir du moment où le protagoniste en entend parler, il peut tenter d’exploiter cette faille et en appeler à l’aspect humain de son adversaire, voire même en menaçant ou en mettant en danger ces satellites. Là aussi, cela ajoute de l’ambiguïté et remet en question les rôles attribués aux personnages de l’histoire : si le protagoniste est prêt à faire du mal à des innocents pour damer le pion à l’antagoniste, lequel est vraiment le plus mauvais ?

Le para-antagoniste
Un para-antagoniste, c’est un antagoniste parallèle. Il s’agit d’un personnage qui n’est pas l’antagoniste principal de l’histoire et qui ne partage pas ses buts, mais qui, pour d’autres raisons, va tout de même compliquer la vie des protagonistes. Bien souvent, un para-antagoniste ne s’oppose pas au personnage principal, mais à un de ses proches. Le cas le plus connu est celui de Jabba, le baron du crime de Star Wars qui fait office de para-antagoniste, principalement opposé au personnage de Han Solo.
Avec l’introduction de ce genre de personnage, on a également l’opportunité de proposer un antagoniste bis qui tranche complètement avec l’antagoniste principal, du point de vue de son caractère, de ses méthodes, du ton qui lui est associé (l’un peut être tragique et l’autre comique, par exemple) ainsi que des thèmes qu’il illustre. C’est par leur contraste qu’ils vont chacun trouver leur place dans l’intrigue.
Un para-antagoniste peut venir apporter un zeste d’incertitude dans un roman. Puisqu’il ne s’intéresse à priori ni aux affaires du protagoniste, ni à celles de l’antagoniste, il peut, au gré des circonstances, choisir de s’allier avec l’un ou avec l’autre – ou corser l’existence des deux.
Bien entendu, un para-antagoniste fonctionne comme un antagoniste, et peut, au même titre que celui-ci, avoir un arc narratif qui lui est propre, ainsi que ses propres sbires, dragons, miroirs, etc… Attention tout de même à ne pas trop en faire et à ne pas surcharger l’intrigue de votre roman avec d’innombrables personnages qui s’opposent aux héros et aux uns et aux autres. Tout le monde ne s’appelle pas G.R.R. Martin.
L’anti-antagoniste
Ce que je choisis d’appeler ici un « anti-antagoniste », c’est un personnage qui est l’antagoniste de l’antagoniste, sans être le protagoniste.
Il y a deux cas de figure principaux qui peuvent se présenter : le premier, c’est celui d’un rival ou d’un adversaire de l’antagoniste, mais qui n’est aucunement lié aux préoccupations et aux affaires du protagoniste. Dans ce cas, il s’agit d’un personnage dans lequel les personnages principaux peuvent trouver un allié potentiel – à moins qu’il ne finisse par se retourner contre eux également. « Les ennemis de mes ennemis sont mes amis » : ce principe un peu trop mathématique peut donner lieu dans un roman à un cas de conscience et à un test moral pour les héros, en particulier si l’anti-antagoniste est à peine moins ignoble que l’antagoniste.
La seconde situation, c’est celle où l’anti-antagoniste se révèle être un super-antagoniste, que tous les personnages, bons ou mauvais, finissent par devoir combattre. Dans sa trilogie « Seven Princes », John R. Fultz révèle ainsi qu’une des motivations des méchants des deux premiers tomes était de prévenir l’arrivée d’un méchant encore plus méchant, qui finit par débarquer dans le dernier volume. Oh, quelle méchanceté! Tout cela m’écœure.
⏩ La semaine prochaine: le style